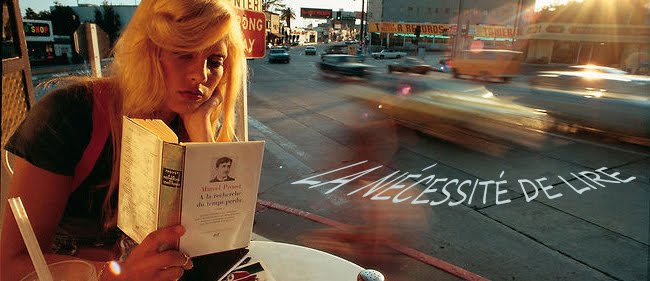Texte consultable : etiennemilena@gmail.com
mardi 29 septembre 2015
lundi 28 septembre 2015
Vivre cent-cinquante ans
Parfois, je me dis que la vie
est mal faite et que la mort est très parfaite. Coupante, déchirante,
cisaillante, la mort. Alors que la vie est oscillante, passionnante, chiante,
exténuante. Toutes ces choses marrantes me hantent.
Je voudrais vivre
cent-cinquante ans, ainsi, je comparerais deux siècles, même trois puisque je
suis de 1981. Je m’engagerais à écrire un livre sur l’évolution anthropologique
de l’humanité jusqu’au XXIIe siècle. Encore faudrait-il que ma cervelle puisse
encore se prêter à ce jeu érudit. Ce qui n’est pas gagné.
Vivre cent-cinquante ans
présenterait de nombreux avantages, encore faudrait-il que mon corps suive.
Pour être dépendant du bon vouloir de l’Etat français une cinquantaine d’années,
autant crever à quatre-vingt ans comme tout le monde.
Vivre cent-cinquante ans, d’accord,
mais sans perdre cette forme d’agilité physique, qui est favorable à la
bandaison. Bah, ce n’est pas que j’entamerais une nouvelle collection de
conquêtes à la Casanova à mes quatre-vingt dix ans (mon physique ne s’y
prêterait pas, quoiqu’une certaine expérience globale de baise (presqu’un
siècle tout de même...) pencherait sans doute dans la balance, à l’heure de la
grande sélection naturelle. Mais je serais bien ingénu de ne pas profiter de ce
rabe octroyé par la vie pour ne pas me défouler les glawis avec de jolies
filles des temps futurs.
À cent-quarante trois ans, je
mentirais bien entendu sur mon âge pour passer mes sept dernières années -
chiffre magique - dans une forme de luxure glorieuse. Si l’humanité n’existe
pratiquement plus à ce moment, offrant le paysage singulier de conflits entre
tribus cannibales, sur une terre partiellement irradiée et totalement déboisée,
je repeuplerais le monde avec une belle indigène. C’est une façon d’acheter un
peu d’éternité à bon prix avant de clamser.
Oui, vivre cent-cinquante ans me permettrait de connaître trois siècles de gloire et de décadence.
Papy rejoindra la terre, après
ces dernières insouciantes galipettes, fort de son experience. On retrouvera son journal flottant sur l'horizon mazouté, après l'enième guerre nucléaire et l'éradication des autres espèces qui offrait en des temps lointains une certaine variété de paysages.
Il s'agirait d'une alternative intéressante
en soi, avec un dénouement somme toute classique.
Etienne Milena, le 28 septembre 2015
samedi 19 septembre 2015
Ludwig Winder, l'oublié
Le devoir (Die Pflicht) de
Ludwig Winder est un grand roman, construit comme une tragédie grecque, où tout
semble obéir aux choix précis d'un horloger, concentré, obsédé par le bon
fonctionnement de l'objet qu'il manipule, réglant tous les mécanismes de son
oeuvre avec dextérité.
Les citations que je vais faire sont
toutes de mon cru, puisqu'à l'heure où toutes sortes de cochonneries sont
publiées en France, aucun vendeur de papiers (excepté en Espagne, en 2014) n'a
eu l'idée, somme toute saine et normale, de traduire et de publier Winder, un
écrivain de premier plan de la littérature mondiale, dans notre si belle
langue. Il est bien plus commun de publier de nos jours des récits auto-fictifs
dérisoires, que de s'intéresser à de grands hommes, ceux "dont les petits
s'évertuent d'effacer jusqu'aux noms" (Calaferte).
L'histoire du Devoir est des plus simples:
Josef Rada est un terne fonctionnaire tchèque qui travaille dans le Ministère
du Trafic de son pays. Il est à la fois dévoué à sa tâche et à sa femme Marie
et son fils Edmund. Son éternel devoir, qu'il accomplit sans se plaindre, est
ce travail que lui a assigné l'existence. Sa vie, banale, semble dénuée
d'intérêt, et les premières pages la relatent avec une économie de moyens qui
donnera le ton à l'ensemble de l'oeuvre : "Dans la rue, on ne pouvait
percevoir rien d'insolite. C'était une matinée froide; il avait neigé. Rada repassait
mentalement une table de tarifs qu'il devait élaborer. C'était un grand
spécialiste en matière tarifaire. Quoiqu'auxiliaire subalterne (il n'était pas
passé par l'Université), peu d'experts étaient capables de se mesurer à lui
dans ce domaine. Il confectionnait les tables les plus complexes, que son chef,
le directeur de la section, remettait au Ministre, en les présentant comme étant
de son fait. "
Les critiques de Winder sont toujours voilées, pour ne pas
créer de déséquilibre dans l'harmonie de son récit. L'ironie noire dont il use
fait immanquablement penser au Kafka de la Colonie Pénitentiaire. Winder fut un grand journaliste, dont les articles aiguisés (principalement pour le Zeit) connurent un succés colossal, jusqu'à sa mort en exil, en Angleterre, un an après la fin de la guerre. L'écrivain fut un ami intime de Musil, et l'un des personnages du Devoir porte le nom de l'écrivain autrichien : il s'agit d'une sorte de double de Rada qui mourra à ses côtés. On pourrait considérer Le devoir comme l'oeuvre testamentaire de Winder puisqu'elle est posthume.
Il fut
l'ami de Max Brod et membre du groupe littéraire Prager Kreist (le cercle
pragois): la filiation avec Kafka est évidente, je l'ai dit, cela malgré le fait que Winder use d'indices spatiaux-temporels tangibles se référant à des réalités
historiques précises et ne s'encombre pas de paraboles (bien que celle du résistant amoureux des fleurs en soit une magnifique). Le roman traite en effet d'un
évenement majeur : l'entrée des troupes d'Hitler en Bohème et en Moravie et la résistance
héroïque des tchèques. À l'arrivée des allemands, dans le livre, l'équilibre est
brisé, la vie de Rada dessine une spirale irrévocable qui le mènera fatalement
à la mort. Mais la cassure est peut-être artificielle et une autre lecture est
possible. La machine infernale de son travail préfigurait déjà l'entrée du
personnage dans l'Histoire avec sa grande hâche. Pour retracer ce
fatum, jamais Winder ne se départ d'une prose chirurgicale, empruntant parfois un
style musical, fait de répétitions qui font paradoxalement penser à Péguy´ou aux grand mouvements circulaires de la caméra de Lanzmann. La
fiction sert à filtrer un témoignage véridique, à s'en distancier pour le
rendre irréfutable par le biais de l'art.
Rada est promu à la section III du
Ministère grâce à l'aide du traître Fobich. Ce dernier, un tchèque à la solde
des nazis, éprouve de la reconnaissance envers le subalterne Rada, lequel, une
quarantaine d'années auparavant, l'a sauvé de la noyade. Il tient à payer sa
dette: c'est son devoir à lui. Mais Rada se montre récalcitrant envers cette
promotion voulue par le traître. Les membres de la résistance tchèque
l'incitent pourtant à l'accepter, pour fournir des informations cruciales en
vue de prochains sabotages (des déraillements) qui seront autant de coups portés
à l'ennemi. Le triste Rada se mue peu à peu en héros malgré lui.
Son excellente mémoire, ses calculs, sa parcimonie, lui seront d'un grand
secours.
Il s'engagera sans doute par désespoir plus que par humanisme. Son
propre fils est en effet emmené en camp de concentration. Mais il n'a plus rien à
perdre. Sa propre famille ne compte plus à ses yeux. Sa propre condamnation,
fortement envisageable, ne lui déplaît plus.
"Il ne monta pas dans un tramway car il voulait
être seul à ce moment. Il traversait des rues animées, seul et isolé comme dans
une forêt solitaire. Il n'avait pas la sensation d'avoir outrepassé les
dimensions de sa modeste existence, de ses modestes capacités et de sa modeste
raison de vivre. L'idée qu'il avait fait preuve du caractère intrépide d'un
héros ne l'avait pas traversé. Il aurait pensé qu'on se moquait de lui si on
lui avait dit que cela avait été une tâche très ardue qui avait nécessité
beaucoup de courage. Mais sur la route le menant chez lui, il comprit peu à peu
qu'il avait laissé tomber ses vieux devoirs, qui supposaient pour lui une
charge aimée et pesante, parce qu'un nouveau devoir l'exigeait, plus pesant
encore."
"Il eut des difficultés à laisser là ses
vieux devoirs. Il avait cru, durant des décennies, que l'accomplissement de ces
devoirs constituait l'essence de sa vie. Mais sa vie avait cessé de lui
appartenir. Jamais il n'avait tenu en grande estime la valeur de sa vie. Jamais
il n'avait médité sur lui-même et sur la valeur de son existence, mais il avait
toujours eu l'idée claire qu'un petit fonctionnaire qui se préoccupait
uniquement du bien-être de sa famille ne devait pas tenir la vie en grande
estime. Il y avait un nombre incalculable de fonctionnaires seulement préoccupés
du bien-être de leurs familles. Chacun était un membre insignifiant de la race
humaine, mais chacun avait sa raison d'être au moment de se préoccuper du bien
des siens. Lui aussi, Joseph Rada, avait eu, pour ce motif, sa raison d'être. À
présent, il avait cessé de se préoccuper du bien-être de sa famille. Il n'était
plus le protecteur de cette dernière, mais plutôt, selon tous les pronostics,
son destructeur. Si Edmund et Marie était capturés et exécutés par les
bourreaux, il le seraient à cause de son oeuvre, par sa faute. Le nouveau et
cruel devoir qu'il avait accompli devait former, à partir de maintenant,
l'essence de sa vie. Il était satisfait parce qu'il avait reconnu son devoir.
Il était satisfait car il avait échappé au danger de ne pas le reconnaître.
Ayant échappé à ce danger, rien ne pouvait plus lui arriver."
Cette contradiction entre le devoir et la
culpabilité, entre le secours et l'action criminelle est savamment mise en
exergue par Winder. Elles peuvent cohabiter chez un même homme. Jeune garçon,
Fobich, le collabo, fut sauvé des eaux par Rada. Le même Rada, en voulant le
sauver de nouveau, entraînera sa mort. Le lecteur est engagé dans une
casuistique puissante. Il est témoin de l'oscilloscope d'une morale qui se forge devant lui, qui ne se prête que difficilement au jeu des définitions,
À un niveau plus prosaïque, je me suis par exemple souvent posé des
questions sur cet affairement égoïste que montrent les familles en public. L'union
qu'on décèle parfois, au demeurant légitime sous bien des aspects, exclut toute
alterité. Le privilège sera toujours donné à l'enfant, au mari, à l'épouse, en un mot au lien direct et immédiat, quand bien même cela passerait par la mort de tout le reste. L'amour maternel?
Mais si un assassin proposait à une mère deux alternatives, sacrifier son
enfant et en sauver mille autres, ou sacrifier mille enfants pour sauver le
sien, douterait-elle un seul instant? Ce bel instinct maternel est très peu soucieux du sort du reste de l'humanité, et très peu maternel en soi. Nous en ferions autant... L'instinct maternel est
d'ailleurs une forme très raffinée de narcissisme, d'amour inconsidéré pour sa
proche chair.
Il existe d'autres manières d'appréhender
l'existence, de chercher d'autres formes de transcendance que ce genre de
clivages dictés par l'espèce. C'est la matière des bons livres.
Le devoir parle de tout cela, et de cette
masse informe du subconscient, du fond de nos existences. Peut-il y avoir une
vie humaine sans morale, sans "il faut", sans commandement de ce qu'il y a de beau en nous? Cette beauté n'est-elle pas relative pour chacun ? N'y-a-t il pas des balises infranchissables, comme l'homicide, l'exploitation des corps? Le nier ne serait-il pas faire un pas vers le fascisme et d'autres systèmes fonctionnant par la pulsion morbide? Plutôt que créer une oeuvre moralisatrice, Winder montre la
somme de possibilités qu'il reste à l'homme pour se concocter un destin, dans
le respect de l'autre, du monde que chacun incarne à sa manière.
Etienne Milena
Citations non-utilisée pour cet article
"C'était l'époque du régime
"tranquille". On pendait seulement les saboteurs que l'on avait pris
en flagrant délit. Mais que quelqu'un soit pris la main dans le sac était très
rare. Le peuple était paralysé. La moindre résistance semblait vouée à l'échec.
Que pouvait obtenir la lutte clandestine alors que l'Europe s'était soumise au
vainqueur et que seule l'Angleterre continuait de combattre? L'Angleterre toute
seule ne pouvait pas aider les peuples vaincus et opprimés d'Europe. Le baron
Neurath disait: "Peuple tchèque, je suis ton protecteur, je veux t'aider.
Soumet-toi et je t'aiderai. Abandonne ta résistance et je te prêterai mon
aide." Presque éteinte, et proche de la désespération, la voix de la
résistance chuchotait : "Résistez!". Et le peuple l'écouta."
"Hitler destitua le baron Neurath. Le chef
supérieur du groupe des S.S., le général de la police Heydrich, le remplaça. Le
peuple tchèque ignorait le nom d'Heydrich et disait: "Le vieux Protecteur
n'a rien pu faire avec nous, le nouveau non plus ne pourra rien faire."
Il y avait à peine une centaine de
tchèques qui connaissaient le nom d'Heydrich. Tous ceux qui le connaissaient
eurent le coeur serré.
Heydrich arriva et se dirigea à Hradcany.
C'était un homme jeune, grand, svelte et blond. Les tchèques qui n'avaient
jamais entendu son nom furent effrayés par son sourire. C'était le sourire d'un
assassin pervers se penchant sur sa victime.
Il sourit quand il reçut le vieux et
tremblant "président de la nation" et les membres du
"Gouvernement" tchèque. En souriant, le nouveau chef leur dictait ses
ordres. En souriant, il leur dit qu'il mettrait de l'ordre en Bohème et en Moravie.
En souriant, il s'assit devant le bureau du grand philantrope Masaryk et lut
les rapports.
Il survola seulement les rapports de la
Gestapo relatifs aux actes de sabotage et les tentatives de résistance de la
population tchèque. Il écouta sans grande attention les récits oraux de ses
agents et des officiers. Il savait ce qu'il avait à faire; la seule chose
importante était la méthode qu'il pensait appliquer. Il était convaincu qu'avec
cette méthode, il ferait plier le peuple tchèque.
Lors des trois premiers jours après son
arrivée, il fit exécuter cent douze tchèques et juifs. Dès lors, il ne se passa
pas un jour sans exécution. Sur le bureau d'Heydrich il y avait des listes et
des nomenclatures. Il en sortait le nom d'un village ou d'une ville et ordonnait
de poursuivre en justice tous les ennemis du Troisième Reich qui y résidaient. Celui
qui était poursuivi en justice était condamné à mort. Celui qui était condamné
à mort était exécuté dans un laps de vingt-quatre heures. La deuxième semaine,
Heydrich établit un programme hebdomadaire. Il était aussi bref qu'un menu qui
prévoit un plat par jour. Il disait :
Dimanche: saboteurs
lundi: bouchers
mardi: auditeurs de radio
mercredi: détenteurs d'armes
jeudi: propagateurs de rumeurs
vendredi: conspirateurs
samedi: espions"
jeudi 17 septembre 2015
lundi 14 septembre 2015
Ailleurs avec Wild Frank
Qu'est-ce que la littérature ? "No materials exist, for a full and satisfactory biography of this man" dit Melville en parlant de Bartleby. Il est intéressant de constater que les français ont traduit "scrivener" par "écrivain", comme si, inconsciemment, ils ne voulaient jamais séparer le motif littéraire de la littérature elle-même. Avec Musil mais surtout Kafka, dont Ludwig Winder reprendra certains traits (comme ces personnages sans réel intérêt littéraire manifeste), sans oublier Pessoa, les auteurs du XXe siècle ont abandonné progressivement l'idée de biographie des personnages. Comme si ce qui se jouait en littérature était ailleurs et que la banalité des professions et des désirs, leurs servaient à définir de meilleure façon cet ailleurs de la littérature.
A la télévision hier, le programme Wild
Frank, au Népal. Cet espagnol quarantenaire jure à chaque instant, son côté
potache fait fureur ici. Cela vaut largement un film d'art et d'essai sur les
gens de la rue. Mais nous sommes dans la jungle. Frank va se rouler dans la
boue avec les éléphants, n'hésite pas à attraper une vipère de Russell qui lui
crache son venin au visage et l'aveugle un long moment. Je me souviens de Bear
Grylls il y a quelques années de cela, qui, en voulant se nourrir du miel d'une
ruche sauvage, se fit piquer par une abeille, traversa un désert la gueule
enflée, lutta contre un serpent cobra, l'étripa, puis le dépeça. Il urina ensuite dans la peau du serpent, noua ce
tuyau rempli de pisse autour de son cou et en but le contenu au milieu du désert. Je
l'avais déjà vu essorer une bouse de vache en Afrique, pour se désaltérer.
Je repense à l'ailleurs, et je ne sais pas s'il existe une autre condition pour créer quoique ce soit, même dans la routine d'un jour de pluie.
samedi 12 septembre 2015
La rentrée
 |
| Anonyme |
La rentrée des classes est la seule qui
vaille. On revoit ses amis, on étudie, on retrouve une certaine routine, une
certaine discipline. Ces années-là nous manquent lorsque nous tombons dans le
monde de l'adulterie, de l'inquiétude du salariat, des traites et des calculs
mesquins. Tout cela m'invite à respecter le travail des
professeurs. J'ai été un élève turbulent qui s'est adouci par l'action
bienveillante de certains d'entre eux, lesquels n'avaient d'ailleurs rien à y
gagner. De nombreux élèves furent sauvés par ces gens si fustigés, de
l'exécrable joug des familles, de leur violence et de leur stupidité. L'école fut
mon refuge. Le collège ma cour de récréation. Le lycée, l'espace de mes amourettes,
presque toujours platoniques d'ailleurs (je me suis rattrapé plus tard à la fac).
Les professeurs nuls, il y en eut, comme
dans chaque corporation. Médiocres et méchants, en perpétuelle carence d'imagination
et d'empathie, ils se vengaient sur les élèves qui ne suivaient pas leurs pas. Les
plus doués étaient leurs cibles privilégiées.
Ma professeur de mathématiques, lors de
mon année de 4e, se plaisait à nous humilier. Elle nous disait que nous étions des ratés, ce que certains ont d'ailleurs cru. Nous,
adolescents boutonneux peu inspirés par l'étude, branleurs compulsifs au physique souvent ingrat, n'avions pas besoin de cela. C'était il y a vingt ans.
Enfin, tout cela pour dire que mon esprit
suit toujours ce temps scolaire, fait d'impulsions et de mille curiosités. Le temps
social du travail sérieux sert à nous engloutir et nous ratatiner. "La médecine,
cette merde" disait Céline. On peut extrapoler et dire que bien peu
d'emplois ne nous aliènent pas et ne nous dessèchent pas prématurément. Il faudrait parfois prendre l'exemple des enfants.
Ils sont mieux organisés et souvent plus cultivés que leurs parents: demandez à
un adulte de vous parler de Roncevaux, il sèchera piteusement. Ce n'est d'ailleurs pas bien grave. En revanche, un élève de
cours moyen sera plus perspicace, il vous répondra avec plaisir, après vous avoir montré son dernier
chef d'oeuvre, car les dessins d'enfants sont ce qui se fait de mieux sur le
marché de l'art contemporain. Il vous racontera également quels instruments dialoguent dans les
Quatre saisons de Vivaldi, comment séparer le grain de l'ivraie après la récolte, comment distinguer les champignons comestibles des vénéneux, tandis que Papa et Maman, eux, parlent de leur nouveau parquet flottant, de la nouvelle voiture des voisins, ou éructent sur Joséphine Ange gardien, et d'autres nains à leur portée.
jeudi 10 septembre 2015
Ma clé USB
J’ai fait tenir mon entière existence,
dans les 8 grammes de ma clé
USB.
Je ne sais pas si elle s’est
alourdie,
ni même si elle a retenu la
moindre phrase
de mon ébranlement intérieur.
Ma clé USB ne craint pas les
intempéries,
Ni le feu qui guette,
imperceptible.
Pour cela, je lui fais
confiance, je la tiens dans ma poche.
Si je m’échappe de la ville,
je peux toujours hiberner dans
une zone de moindre risque,
ressasser mes 16 Gigabytes de
douloureuses introspections
Marmonner, impénitent, mon
insatisfaction globale
Je peux aussi m’effondrer sur
la route,
reçevoir la balle perdue d’une
partie de chasse,
Singer l’agonie.
Qu’on me fasse les poches,
Que restera-t-il ?
Une clé USB hermétique et
tenace
Que le voleur jettera dans les
broussailles,
Un fond d’éternité rendu à la
terre,
Biodégradable comme tout le
reste.
mardi 8 septembre 2015
samedi 5 septembre 2015
Les trois classes d'individus
Je me promène avec B., mon
grand ami architecte, dans les rues de notre ville castillane. Son air jovial d’adolescent
quarantenaire me distrait de moi-même, de tout ce poids superflu. Il s’arrête à
chaque édifice et me livre une anecdote sur l’auteur de l’oeuvre qui se dresse
devant nous, car il connaît tous les membres de cette corporation. Ça fuse. « Este
es un tonto de remate: mira que idiotez que este hombre » (« celui-ci
est con à bouffer du foin: regarde l’idiotie de cet homme. ») me
dit-il en me montrant un bloc surmonté de deux cheminées grotesques. C’est vrai
que cet espace grand guignolesque ne réjouit pas la rétine. Nous bifurquons
vers une autre zone. « Este es un pedante » (« celui-ci
est un pédant. »), clame-t-il devant un hôtel post-franquiste
imposant. Il est vrai qu’on devine une personnalité sans grandes idées dans ces
formes stridentes. Un plouc en cravates, du genre banquier. « Efectivamente »
me confirme B., je viens de décrire l’auteur de ce sinistre repère à rentiers
désoeuvrés, que B. connaît personnellement. Puis nous nous arrêtons
devant une école de Beaux-Arts: là, il se fait doux comme un agneau, presque
mélancolique: « Mira este, se suicidó: amaba exesivamente a la vida »
(« celui-là s’est suicidé: il aimait excessivement la vie »).
Nous admirons le bâtiment moderniste de couleur jaune et bleue. Tout s’enchevêtre
avec une élégance discrète. Les oiseaux chantonnent, comme pour acquiescer. « Una
persona deliciosa. » ajoute mon ami.
B. m’a rappelé ces lecteurs
qui choisissent les livres en fonction du visage de leurs auteurs.
Il a face à la laideur des
bouffées de haine que je ne m’explique pas. L’architecture est selon lui comme
la chirurgie esthétique, mais imposée à des milliers de personnes. Mais on peut
difficilement se dépêtre d’un bâtiment qui défigure un paysage, alors qu’un nez
boursouflé peut être transformé par un coup de bistouri. Ce qui est en soi
révoltant.
Je lui parle d’Ashgabat, et de
Tel Aviv. Si j’avais été dictateur, j’aurais choisi d’exercer ma profession en
Turkménistan, pour faire défiler mes armées dans ces amples avenues de marbre
immaculé ouvertes au grand jour. Mon palais aurait cette touche d’indolence
orientale dont les turkmènes raffolent.
Nous nous asseyons à la
terrasse d’un bar tenu par un couple d’homosexuels bosniaques, ce qui consolide
la tournure cosmopolite de notre promenade.
B. aime ma classification antropologique des classes d’individus. Il l’utilise à tout bout de champ. Il y en bien trois selon moi : les hommes de désir, les consommateurs et les fétichistes.
L’homme de désir est un homme
d’action, il agit par négation du réel et se projette incessamment. La virilité
est sa vertu. Il a besoin de scruter l’horizon, de chasser, de construire.
Le consommateur jouit et
jette. Il ne fait que cela. C’est l’écrasante majorité. Peu d’imagination est
ce qui le caractérise le mieux.
L’homme d’église par exemple fait partie de cette classe. Car le dévôt ensoutané consomme Dieu comme d’autres les yaourts allégés en sucre.
L’homme d’église par exemple fait partie de cette classe. Car le dévôt ensoutané consomme Dieu comme d’autres les yaourts allégés en sucre.
Le fétichiste, lui, ne s’intéresse
à la vie que pour en garder une trace, une histoire à se raconter. Il
collectionne les morceaux du réel et, s’il consomme son amour, c’est surtout « l’idée »
de l’amour qui fait partie du champs de ses obsessions. Sa femme peut
déguerpir, il se construira des songes consolateurs. Les fétichistes sont les
écrivains plus que les peintres. Il peut entrer une part de narcissisme dans
cette classe d’individus, mais la solitude ne leur est pas une charge. Il n’ont
pas besoin d’applaudissements pour survivre. Ils sont leur propre coopérative
auto-suffisante. Leur propre prison dorée... quoique parfois sordide.
A mon goût pour les
supermarchés et les bibliothèques publiques, je me sens proche del « hombre
de la multitud », mais je déplore tout de même que les autres espèces
soient en voie de disparition, alors il me plaît de penser que je navigue
parfois entre les deux autres, comme B.
Enfin, si je n’ai pas un petit
creux avant.
Etienne Milena ©
jeudi 3 septembre 2015
Le grand ménage
Ce matin, j’ai fait le
ménage.
Je fais partie de la première
génération qui a pu échappé au service militaire, mais j’ai gardé l’habitude de
frotter le sol et remuer la poussière sans ordre depuis en-haut dès mon plus
jeune âge. Cela me permet également d’écouter de vieilles musiques oubliées sur
ma radio, qui lit les Mp3. Emile et image ou Félix
Gray font mon ravissement. Ça repose l’esprit. Cette déconnexion
progressive des neurones est en même temps très utile. On sort de cette
méditation avec un appartement remis à neuf, et des sols qui brillent et
sentent le citron.
C. a essayé de me pousser il y
a peu dans une classe de méditation, c’était dans le sous-sol d’une entreprise
de co-working. Des câbles pendaient au plafond, on aurait dit que nous allions
entamé quelque orgie dans un hangar désaffecté ou un obscur shoot collectif. La
vérité, c’est que nos actes semblaient prémédités par une loi tacite, celle qui
consistait à ne pas laisser l’autre deviner nos multiples névroses. Cela
ressemblait à une banale réunion d’alcooliques anonymes venus cette fois-là
pour s’étirer les fesses. La pudeur qui émanait du groupe était forcée. J’étais
sorti de cette première session plein d’idées sombres. Le discours du yogi ne m’avait
pas plu. La respiration en kapalobati m’avait laissé plus nerveux que je
lorsque j’était entré. Je suis persuadé depuis qu’un type de surventilation
peut avoir une incidence néfaste sur l’anxiété.
J’avais déjà essayé le
kundalini avec une jeune psychologue, M. recommandée par mon voisin, un
peintre expressionniste qui travaillait dans un abattoir de nuit. M. était une
jolie castillane, avec des rondeurs qu’excusait sa grande sensualité. J’admirais
sa tonicité et sa manière d’enrouler sa serviette blanche autour de sa tête
avant chaque séance. Une mèche dépassait parfois de ce fin tissu. À ses côtés,
un type louche, qu’on devinait éperdument amoureux d’elle, assistait à ces
galipettes mystiques avec passion. Son excès de zèle le trahissait. Je me
souviens très bien du creusement des reins de M. quand elle nous faisait nous
accroupir et faire des sortes de pilates mélangés à des salutations au soleil.
Nous récitions des mantras le vendredi à 6h du matin, jusqu’à l’apparition du
soleil, justement. Puis nous déjeûnions. Elle nous faisait du thé à l’orchidée
sauvage. J’apportais quant à moi des pitchs fourrés au chocolat. J’y suis allé
trois fois. Mais la paresse me gagna et j’oubliais bien vite ce devoir
hebdomadaire sur moi-même.
Je m’inscrivis une fois à la Bio Danza de l’association des voisins. Nous nous
caressâmes la tête et dansâmes sur "Happy feet" dès le premier
jour. Tant de proximité fit paradoxalement s’estomper toutes les
pensées interlopes. J’eus néanmoins la bonne idée d’être le seul garçon, ce qui
évita les jalousies et autres comparaisons mesquines. Quelques femmes en
pré-retraite venaient s’ajouter à la fête et en sortaient revigorées. Elles
allaient ensuite à l’herboriste de la même rue acheter du pain intégral et
retrouvaient leurs maris dépressifs à la fin de la journée. Je les croisais
parfois dans le centre ville, accompagnés de ces pauvres bougres, dans la
routine de diverses courses. Nous échangions des sourires empreints de
bieveillance et de compréhension mutuelle.
Mais j’ai délaissé la Bio
Danza au bout de cinq sessions. Les maris nous surprirent en train de nous
chatouiller les aisselles sur du Sting, car la monitrice avait
laissé la porte entrouverte pour faire circuler l’air. Je ne voulais pas de
conflits. Ma lâcheté fit le reste. Je m’éclipsai.
À présent, je médite une à
deux fois par semaine avec ma serpillère et Emile et Image, avec
cette sensation d’atteindre ce ramollissement jovial des sentiments tant
recherché.
mardi 1 septembre 2015
Gnossiennes
Dans la solitude de sa
chambre, Satie composait.
A ses vingt ans, il vécut à
Montmartre. Ses amis étaient Ravel, Debussy, Picasso. Il jouait du piano dans
les cafés. Les musiques orientales, découvertes lors de l’exposition
universelle de 1889, eurent une grande influence sur lui.
A trente ans, sans le sou, il
s’exila en banlieue, à Arcueil.
Comme un oiseau tapi au coin d’une
fenêtre, il attendait que l’hiver cesse. Au dégel, il tapait sur les gouttières
et les tuyauteries pour créer de nouveaux sons. On le croyait fou.
Les voisins le maudissaient.
Il fut l’unique hôte de son
église. L’automne surtout, il regardait tomber les feuilles. Il cherchait des
rythmes dans la nature qui pourraient nourrir son oeuvre.
Il se levait tôt et suivait un
horaire strict. Chaque repas, chaque note, devaient obéir à un plan défini. Il
distinguait chaque minute de l’existence, comme si les aiguilles de son horloge
étaient deux diapasons. Son regard était celui d’un orfèvre.
Il étudia très tard la
musicologie pour parfaire son art. Il haïssait l’esbroufe. Malgré son âge, il
fut un brillant étudiant, toujours soucieux de se perfectionner.
Il n’était pas romantique.
Mais l’argent ne l’intéressait pas. Un jour, une revue lui proposa une collaboration.
La somme qu’on devait le payer ne l'avait pas convaincu, il la jugeait excessive. Il
s’emporta.
Il n’aima qu’une seule femme,
la peintre Suzanne Valadon. Il l’appelait Biqui, il lui écrivait des poèmes.
Elle le laissa pour un banquier. Cet amour définitivement perdu lui fit écrire
les Vexations, qu’il recommanda de jouer 840 fois d’affilée à ses interprètes.
Son art s’éleva par cette
absence insurmontable. Il fit revivre Biqui par la musique. Il mourut
misérable, sans que ses amis ne se doutèrent de l’état calamiteux de ses
finances, car il ne reçevait jamais personne à Arcueil. Il laissa une oeuvre
qui elle, n’a jamais veilli, qui exprime l’anxiété et les désirs hésitants d’une
âme emplie de mélancolie, cloîtrée dans l’attente. Les mots ne suffisent pas à
rendre justice à la musique de Satie, et ce n’est pas une pirouette langagière,
ni un prétexte donné à la paresse que de le dire. Il faut s’emplir de ses
Gnossiennes jusqu’à satiété pour comprendre que les analyses seront toujours
insuffisantes et que ces notes qui tournoient au-dessus de nous comme des nuées
d’oiseaux sont là pour nous faire oublier le plat langage de la Communauté.
Inscription à :
Articles (Atom)