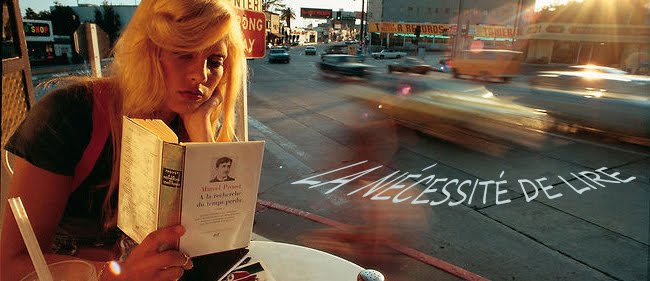« Son rêve était de vivre dans une société honnête,
parce que la mauvaise société, disait-elle, c’était comme un coup d’assommoir,
ça vous cassait le crâne (…) »
Emile Zola, L’Assommoir
Il aura fallu quelques siècles
de tergiversations pour que le Roman soit plébiscité par les foules et les lecteurs compétents. Jusqu'alors, il n'était qu'une manière de diversion pour des lectrices qu'on jugeait d'une impayable sottise. Quel est ce moment où il trouva sa légitimité ? La
relation qu’il noue avec l’idée de démocratie – puisqu’il est à la fois le
reflet d’une subjectivité dans le monde et le miroir d’une société en phase de
démocratisation – l’aurait plutôt desservi.
Ce qui lui a donné un semblant de
crédibilité, ce qui lui aurait fait entrer de plain pied dans l'histoire littéraire se mesure aux nombres de « il faut » qu’il se met
à laisser entendre : en d’autres termes, sa prise en considération de visées morales hisse le roman au niveau des genres majeurs. Pour devenir
crédible aux yeux de tous, il a du se mettre à impliquer une
leçon de vie, une réflexion susceptible de parfaire la conscience de ses
contemporains.
L’influence du mélodrame dans le champ romanesque dans la première moitié du XIXe siècle n’a fait
qu’intensifier cette profusion d’ingrédients empreints de moralisme. Et l’influence chrétienne n’a pas été moins forte dans l’élaboration du genre.
Au XIXe siècle – comme par la suite – Dieu n’en est qu’aux prémisses de sa lente agonie.
S’il faut s’arrêter brièvement sur la
culture chrétienne de grands romanciers du XIXe siècle, contournons cet écueil en choisissant d'emblée celui dont le background religieux se déverse dans son œuvre toute entière, dans une Russie en émoi : Fédor Dostoïevski. Il ne faudrait pourtant pas voir dans un
travail d’écriture connoté de religiosité l’œuvre commune d’un plat dévot.
Dostoïevski est l’écrivain du doute et cette idée même de
l’existence de Dieu restera selon ses propres dires l’unique et véritable
interrogation de sa vie.
Les références bibliques de Dostoïevski servent une problématique beaucoup plus
large que la simple démonstration menant à la leçon morale. La parabole biblique ne lui sert pas d'illustration, mais de source de création. Crime et châtiment, avant d'être le sismographe exceptionnellement orchestré d'une errance intérieure, est l'illustration du message rédempteur du
livre sacré. Les Evangiles
furent les seuls ouvrages autorisés à Dostoïevski lors de ses quatre années de
bagne et nul doute qu’ils s’inscrivirent dans sa conscience à l’image du manuel
d’échecs du détenu de Zweig dans Le Joueur d’échecs. Il existe cependant
une marge entre la connaissance d’une œuvre, fût-elle parfaite, et son
application quotidienne.
Dans Les Démons, le message est
clair, voire radical : le nihilisme ne mène à rien, la seule voie possible
réside dans l’application du message christique, a fortiori lorsqu’on parle de
l’identité nationale russe. L'identité nationale russe... N’était la vitalité du texte dostoïevskien, une
telle idée serait par trop ténue pour qu’on se penche trop longuement sur
elle en d'infinis articles.
Les Démons fait partie des derniers longs romans sombres de l’écrivain, avec L’Adolescent et Les Frères Karamazov.
Nous y retrouvons d’ailleurs l’esquisse de la figure religieuse centrale des Frères
Karamazov, pavé dont tout le monde parle mais que personne ne lit. En effet, le Tikhone des Démons n’est pas sans rappeler le starets Zosime, dans ses paroles pétries de sagesse (Tikhone paraissant
toutefois davantage hérétique, ce qui convient relativement bien à l’atmosphère
de déchéance nihiliste du roman). Par ailleurs, ce n’est pas un hasard si Les
Démons s’achève sur l’entrevue de ce vieux sage avec Stavroguine. Ce genre
d’entretien entre deux êtres appartenant à des univers diamétralement opposés,
l’un religieux et l’autre atteint d’insanité, aura à nouveau lieu dans Les
Frères Karamazov, quand le starets accueille le père d’Aliocha qui se lance
tout de go dans ses bouffonneries équivoques. Nous revenons sur ce passage à dessein, tant
il est emblématique de la tournure que prend l’œuvre de Dostoïevski dans les
dernières années de sa vie.
Le personnage du starets renvoie à l’idée de vieillesse, mais surtout de
sagesse éclairée. Il est aussi ce Père de l’église, représentant des valeurs de
tolérance et de compassion, médium du message christique comme la lumineuse putain de Crime et châtiment. L’application de ses
valeurs et principes reste la seule alternative qui échoit au peuple russe pour
qu’il soit sauvé de sa gangrène nihiliste. Face à lui, le père Karamazov
« singe son idéal », pour reprendre une expression de Nietzsche. Il est ce père qui
minaude, qui s’enlise dans une rhétorique marquée de déraison plus que de
dérision, il est ce symbole du pouvoir familial crucial qui s’absente et s’absout
de ses vices. Cette absence du père est entérinée par sa mise à mort.
L’idée de parricide est
également latente dans Les Démons. Stéphane Trophimovitch est dénoncé
par son fils, qui le « suicide » indirectement, si l’on nous permet
d’user d’une telle expression. Le parricide est le symbole de l’ingratitude des
fils, d’une société nouvelle qui fait table rase des valeurs qui semblaient
pourtant ancrées dans l’idiosyncrasie d’un peuple, pour lui substituer le monde
de la concupiscence et de l'appétit de soi.
Les Démons montrent le manque d’issue face à cet état de fait, la fin du roman
pouvant être perçue comme un schéma à rebours de celui de Crime et châtiment,
puisque le livre se conclut sur une rédemption ratée – Stavroguine se suicide
et commet donc le plus grave des crimes – au lieu d’une résurrection
spirituelle comme c’est le cas pour Raskolnikov. Ici aussi, la référence
utilisée par Dostoïevski pour illustrer les agissements de ses protagonistes
est clairement extraite du texte sacré : il ne s’agit plus de Lazare comme
c’est le cas dans Crime et châtiment mais d’un passage de l’Apocalypse
repris à la fois par le père devenu fou, Trophimovitch, et le fils suicidé de
Varvara Pétrovna, Stavroguine, tous deux avant leurs fins tragiques.
C’est bien ce passage, ou bien plus, ce « déclin » de la pensée des
pères vers les fils que Dostoïevski a voulu mettre en lumière dans son
roman : « C’est cette parenté, cette permanence de l’idée qui se
développe en passant des pères aux fils que j’ai voulu exprimer dans mon
œuvre. » nous dit-il dans sa préface. La pensée pseudo « révolutionnaire » des pères trouve son
prolongement immédiat dans la destruction pure : et Dostoïevski
d’esquisser indirectement une réflexion sur la transmission du savoir
(puisque Verkhovensky est l’élève de Trophimovitch) : celle-ci devient trahison.
L’écrivain nous laisse entendre en ce cas l’origine commune de ces deux notions.
Dans le cas d'un autre écrivain majeur du même siècle, Emily Brontë, c'est la morale victorienne qui s'immisce dans l'art. L'époque
durant laquelle elle publie son roman est souvent perçue par les critiques
comme une période d’apogée teintée d’un bas moralisme, d’un matérialisme et
d’une expansion coloniale anglaise tendant à dévoiler l'égocentrisme latent
d'un Empire glouton. Telle est l’avis d’un Stephen Zweig qui parle du rapport de
Dickens avec cette époque victorienne en ces termes cinglants :
« C’est seulement lorsqu’on hait du plus
profond de son âme l’étroitesse hypocrite de la culture victorienne qu’on peut
mesurer, avec une entière admiration, le génie d’un homme qui nous a forcés à
trouver intéressant et presque digne d’amour ce monde antipathique du
rassasiement et de l’embonpoint (…). »
Il ne s’agira pas de gloser à
l’infini sur le bien fondé d’une telle condamnation. Réglons le problème sur le
champ en affirmant que l’œuvre de Brontë n’est que modérément le reflet de son
époque.
D’abord, le cadre du roman, nous l’avons
dit, se situe dans un no man’s land spatial et mental. La solitude envahit le
lieu, jusqu’au nouvel arrivant, Lockwood, qui est célibataire, et isolé comme un chien citadin abandonné sur une route de campagne. Emily
Brontë se sert du caractère angoissant de ces paysages pour donner une
atmosphère gothique à son roman.
Le
roman de Brontë est tendu vers un passé mythique, même si l’histoire principale
a seulement lieu quelques années avant le temps de la narration, nous l’avons
dit, dans les dernières décennies du XVIIIe siècle. A l’image d’un Stendhal,
mais pour des raisons toutes autres, Brontë appartient d’une certaine façon au
siècle qui la précède. Les traditions, la juste répartition des tâches dans
cette mini-société qu’est la famille de Wuthering Heights sont
clairement perceptibles. Un point commun notable la rattache pourtant à l’époque
victorienne où elle écrit : une certaine politesse de fond dans les relations
(certes bousculée par les agissements de cette formidable figure récalcitrante du nom d'Heathcliff), une certaine manière
d’appréhender le silence, manière à laquelle participe l’espace désertique du roman.
La famille telle que Brontë
la montre est étrange comme son paysage. Nous nous retrouvons dans le roman, au cœur d’une opposition devenue
bancale entre liaison amoureuse et mariage forcé. En effet, les mariages
arrangés de la story sont autant marqués du sceau de l’immoralité que les liaisons et les amours
quasi-incestueuses qui la composent. Aussi, sans glisser sur la pente douteuse
de la leçon morale, l’œuvre de Brontë s’astreint à donner la parole à une voix
à la fois raisonnée et dépassée par les évènements, pour essayer de retrouver
une logique interne à ce réseau de relations chaotiques : cette voix, c’est
celle de Nelly, une domestique fort sage et terriblement équilibrée.
Nelly Dean est cette haute figure d’une
société traditionaliste qui ne manque pas de repères. Les remontrances de Nelly
ont toujours ce fond reconnaissable de simple éducation religieuse qui explique les choses d’une manière rudimentaire et arrondie. Elle s’évertue de répéter les
leçons du texte sacré, la juste répartition des tâches, les règles de vie dont
elle est le chantre. Ainsi
dit-elle à Heathcliff, qui s’écarte des sentiers battus de la morale chrétienne
:
“ 'For shame, Heathcliff!' said I. 'It is for God to punish wicked people;
we should learn to forgive.' ”
Le pardon fait partie des valeurs qui lui sont chères, au même titre
que de simple marques de piété. Ce qu’elle reproche à Heathcliff, c’est bien
son indépendance face au créateur, son manque de piété, qui l’engage dans la
voie du blasphème :
“He [Heathcliff] neither wept nor prayed; he
cursed and defied: execrated God and man”.
Face
à Isabella, le sermon et la rhétorique de la domestique ne changent guère.
L’acte de l’ouverture du texte sacré est toujours l’indice d’une conscience
proprette, un acte qui, négligé, instaure le doute quant à la valeur morale
d’une personne :
« 'Fie, fie, Miss!' I
interrupted. 'One might suppose you had never opened a Bible in your life. If
God afflict your enemies, surely that ought to suffice you. It is both mean and
presumptuous to add your torture to his!' ”
Plus tard, lorsque Nelly se lance dans une
comparaison entre Linton et Hindley, on ne peut voir au début que
peu de différence entre les deux personnages. La valeur morale des deux
prédomine, surtout lorsque Nelly use d’un jargon connoté d’une morale primaire,
avec ses idées de destin, de bien et de mal :
“I could not see how they
shouldn't both have taken the same road, for good or evil.”.
Ce qui fait finalement la différence au fil
de sa description, c’est la piété de Linton qui l’élève aux yeux de la servante
vers d’autres sphères :
“Linton, (...) displayed the true
courage of a loyal and faithful soul: he trusted God; and God comforted him.”.
De tels exemples sont très fréquents dans le roman. Nelly a beau s’en
prendre nommément à Joseph qu’elle qualifie de « Pharisee " elle n’en demeure pas moins tout autant le produit d’une culture marquée par
une morale chrétienne. Il est vrai cependant qu’elle se montre supérieure au vieux serviteur, dont la manière de parler est
sciemment retranscrite par l’écrivain dans tous ses écarts pour faire rejaillir
le caractère primitif du personnage.
Ainsi, comme dans la vie réelle, dans Wuthering
Heights, les personnages les plus moralisateurs sont issus des couches
inférieures de la société. Le fil d’une narration principale donnée à une
domestique n’est pas le fruit d’un hasard. Cela permet à l’écrivain d’instaurer
un contraste entre la vision et la voix naïve et « innocente » d’un
être simple et une story complexe qui investit en profondeur les
rouages des passions humaines, procédé très utilisé un siècle auparavant lui-même héritier du "nice" médiéval. Est-ce à dire
(grossièrement du moins) que ce monde des passions serait celui du Mal et que
Nelly représenterait celui du Bien, à l’image de l’Idiot de Dostoïevski lequel est, rappelons-le, un prince et non un moujik ?
Il serait fort hâtif de conclure cela. La narration du roman n’est pas simple,
car elle n’est pas seulement donnée à la servante. Emily Brontë commence par
utiliser la voix de cet autre pourvoyeur de bonnes pensées qu’est Lockwood, cet
homme pourtant moins fermé que son nom le laisse augurer. Ainsi, son ironie
face au bigotisme de Joseph est d’emblée visible. Il s’agit là d’un trait d’ « humour »
tout britannique
:
«
[...] looking,
meantime, in my face so sourly, that I chaitably conjectured he [Joseph] must
have need of divine aid to digest his dinner, and his pious ejaculation had no
reference to my unexpected advent. »
Pourtant, nous
devons bien nous résoudre à voir dans Lockwood un instigateur de valeurs
familiales, à l’image de Nelly (laquelle sacrifie d’une certaine manière son
existence pour des mécréants),
puisqu’il veut se marier avec Catherine. Lockwood est pétri d’une sorte de
transparence bourgeoise. Il est aussi propre que les draps de la servante
dévouée. En ce sens, il est son prolongement bourgeois.
Les deux figures narratives obéissent à un souci d’ordre moral, c'est-à-dire à
la volonté de prodiguer les valeurs du bien-penser, et à un souci d’ordre
éthique : en l’occurrence l’instauration du bien-agir en ces lieux
obscurs.
*
En ce qui concerne le troisième auteur qui fermera ce tryptique ponctuel, Zola, le roman
familial prend d’autres proportions. Il faudrait prendre l'intégralité de ces volumes pour en extraire l'unicité, ce qui n'est pas une mince affaire. Des lectures d'une belle teneur nous en prive pour l'instant, et les journées ne se forment que de vingt-quatre heures. C’est bien une peinture des mœurs de son
temps que Zola a voulu faire, ou plutôt une fresque, puisque les Rougon-Macquart
s’étendent à une vingtaine de romans se reflétant les uns les autres.
L’influence de l’art pictural sur l’oeuvre de Zola est d’ailleurs notoire, plus que les lectures. L’histoire
littéraire a fait de l’auteur de Germinal la figure de proue du
naturalisme romanesque, ce qu’il a été, bien entendu. Cependant, l’usage d’une méthode scientifique visant au réalisme dans
l’élaboration d’un art romanesque n’exclut en aucun cas l’engagement de
l’auteur, ni sa prise en considération de certaines lectures romantiques de sa
jeunesse, lesquelles réapparaissent volontairement ou non dans sa prose.
L’héritage du scientisme ou des recherches anthropologiques de son époque
n’incite pas Zola à faire l’impasse sur idée d’une écriture porteuse de leçons
pour ses lecteurs.
Zola envisage son œuvre future
comme on entreprend l’élaboration d’une vengeance, d’une façon comparable à
celle de Flaubert qui appréhende Bouvard et Pécuchet comme son « livre
des vengeances »,
à la différence que ce dernier s’est toujours évertué de dénoncer la bêtise
de ses contemporains en suivant la technique narrative de l’impassibilité totale,
ce qui n’est pas toujours le cas de Zola.
Jeune provincial empli d’idéaux
et d’ambition, arrivé (dans le cas de Zola, on pourrait dire
« revenu ») dans la capitale à l’image d’un personnage balzacien,
Emile Zola confie à son ami Cézanne son intense dégoût face aux vices de ses
contemporains et l’impulsion que ce dégoût lui permet d’avoir pour entamer son
travail d’écriture:
« Moi qui aurais pu me disculper, je ne
voulus pas descendre jusque-là: je conçus un autre projet: les écraser sous ma
supériorité et les faire ronger par ce serpent qu'on nomme l'envie. Je
m'adressai à la poésie, cette divine consolation: et si Dieu me garde un nom,
c'est avec volupté que je leur jetterai à mon tour ce nom à la face comme un
sublime démenti de leurs sots mépris.»
Etienne Milena